L’Église catholique est en deuil. Jorge Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de pape François, le 266e pape de l’histoire, est décédé à l’âge de 88 ans après douze ans de pontificat.
Plus d’une décennie de travail en tant que figure de proue de l’Église, marquée sans aucun doute par son style pastoral particulier, son approche sociale et un travail plein de lumière et, pour ses détracteurs, aussi de quelques zones d’ombre. À cela s’ajoutent ses décisions au sein de la toute-puissante Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d’Istituto per le Opere di Religione (IOR).
Cette organisation, qui gère les fonds destinés aux œuvres religieuses et caritatives du pape, a été au fil de l’histoire l’objet d’admiration, mais aussi de différents scandales. Aujourd’hui, avec la fin du pontificat de François, il est temps de savoir dans quel état le pape laisse cette institution.
Alors que beaucoup s’attendaient à une révolution dans la gestion financière du Saint-Siège sous le mandat de François, les changements ont été moins ambitieux que prévu.
Le pape a promu certaines mesures de transparence, mais la complexité de la structure vaticane et les résistances internes ont limité la portée de ses réformes.
L’IOR, entre foi et finances
La Banque du Vatican a été créée en 1942 pour gérer tous les fonds destinés à des causes religieuses. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une banque conventionnelle, elle fonctionne de manière très similaire : elle offre des services de dépôt, de transfert et de gestion d’actifs.
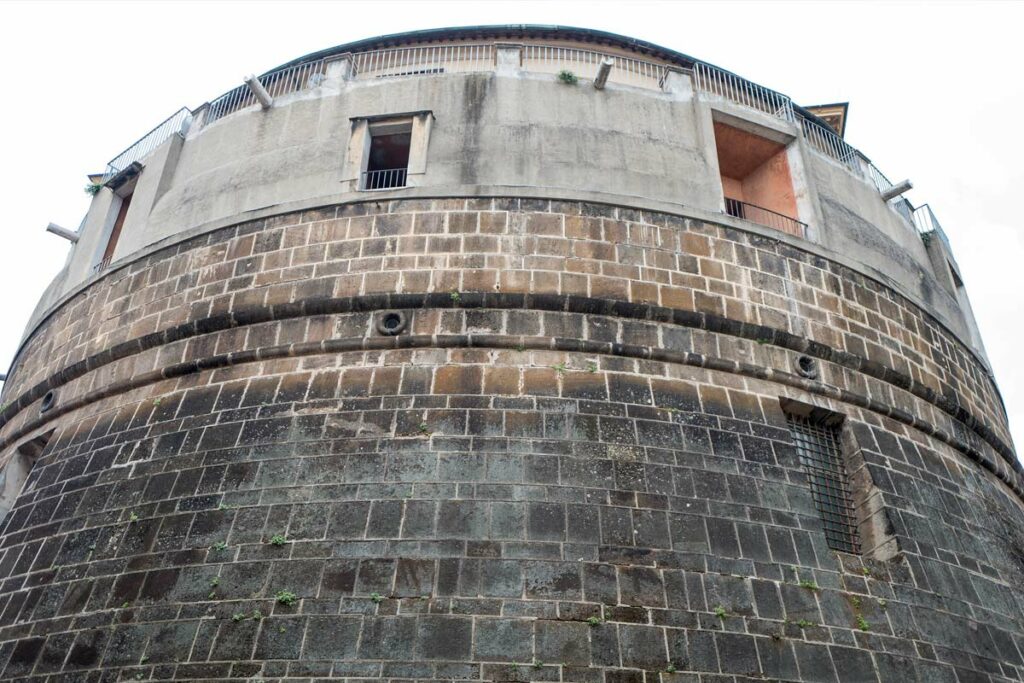
Ses clients comprennent des congrégations religieuses, des ordres, des dicastères, des évêques et certains particuliers liés à l’Église. Elle gère des fonds dépassant les 7 milliards d’euros, provenant notamment de 5 200 institutions catholiques.
Depuis douze ans, l’IOR publie son rapport annuel. Celui de 2023 a montré une institution solide sur le plan financier : elle a réalisé un bénéfice net de 30,6 millions d’euros, avec une marge bancaire de 49 % et un ratio de solvabilité TIER 1 de 60 %, l’un des plus élevés au monde.
Cependant, ces chiffres contrastent avec la situation générale des finances du Vatican, qui, à la fin de 2024, étaient officiellement au bord de l’effondrement.
Les scandales financiers qui ont secoué le Vatican au cours de la dernière décennie
La Banque du Vatican a été au centre de nombreuses affaires controversées tout au long de son histoire. Au cours de la décennie 2010, une série de scandales a ébranlé les fondements de sa réputation.
Des comptes cachés dans des paradis fiscaux, des transactions douteuses à destination incertaine et un manque alarmant de contrôles internes permettant le détournement de fonds à des fins abusives ont été découverts.
L’un des épisodes les plus controversés a été l’affaire du cardinal Angelo Becciu, condamné en 2023 à cinq ans et demi de prison pour fraude et gestion risquée des fonds du Vatican, notamment pour l’acquisition ratée d’un immeuble à Londres.

Ces révélations ont mis en évidence l’utilisation discrétionnaire des dons provenant des fidèles à des fins obscures et la participation d’intermédiaires financiers externes qui se sont enrichis grâce à l’opacité régnante.
Selon les documents judiciaires, le Saint-Siège a dilapidé des millions d’euros dans des paris spéculatifs à haut risque, ce qui a eu un fort impact tant sur le plan économique que sur sa réputation internationale.
Les réformes impulsées par le pape François
Dès le début de son pontificat, le pape François a insisté sur la nécessité de gérer les ressources économiques de manière transparente et responsable. En novembre 2013, le cabinet d’audit Ernst & Young a été engagé pour réaliser des audits externes afin d’écarter toute irrégularité.
En 2014, il a créé le Secrétariat pour l’économie et encouragé la réalisation d’audits internes et externes périodiques. Il a clôturé les comptes suspects et renforcé les mécanismes de surveillance, en introduisant des contrôles plus stricts sur les investissements et les dépenses.
Le Souverain Pontife a également clairement fait passer le message suivant : l’argent de l’Église doit être au service des plus démunis, et non du profit personnel. Cependant, la portée réelle de ses réformes a eu ses limites. De nombreuses limites.
Malgré les bonnes intentions initiales, les changements structurels n’ont finalement pas été très profonds, et les résistances internes ont freiné une rénovation plus profonde du modèle financier du Vatican.
Dès 2010, le pape Benoît XVI avait promulgué une nouvelle loi visant à prévenir le blanchiment d’argent. Cependant, quinze ans plus tard, plusieurs affaires ont terni les annonces du Vatican à cet égard.
La crise financière complexe que traverse le Saint-Siège

Malgré les solides performances de l’IOR, le Saint-Siège est confronté à une crise économique complexe. Le pape a admis dans une longue lettre à la Curie que les caisses étaient vides et qu’il n’y avait pas suffisamment de fonds pour payer les retraites.
Le système de sécurité sociale labyrinthique du Vatican est insoutenable à moyen terme et nécessite une réforme urgente et difficile.
La baisse des dons, en particulier dans l’Opéra de Saint-Pierre, a également exacerbé la situation. La crise post-Covid, la réduction du tourisme religieux et la désaffection des grands donateurs n’ont pas non plus aidé le Saint-Siège.
Il est vrai que le pape François a mis en œuvre une politique nécessaire de réduction des dépenses dans tous les dicastères, y compris les médias et autres services curiaux. Mais l’absence de réformes en profondeur, malgré la bonne situation de la Banque du Vatican, continue de placer la grande maison catholique dans une situation compliquée.
La possibilité de vendre des biens immobiliers, de promouvoir l’utilisation du patrimoine du Vatican pour obtenir des revenus supplémentaires ou le Jubilé de 2025 sont autant de « miracles » attendus par les comptes du Vatican.

